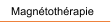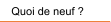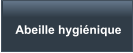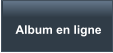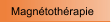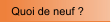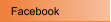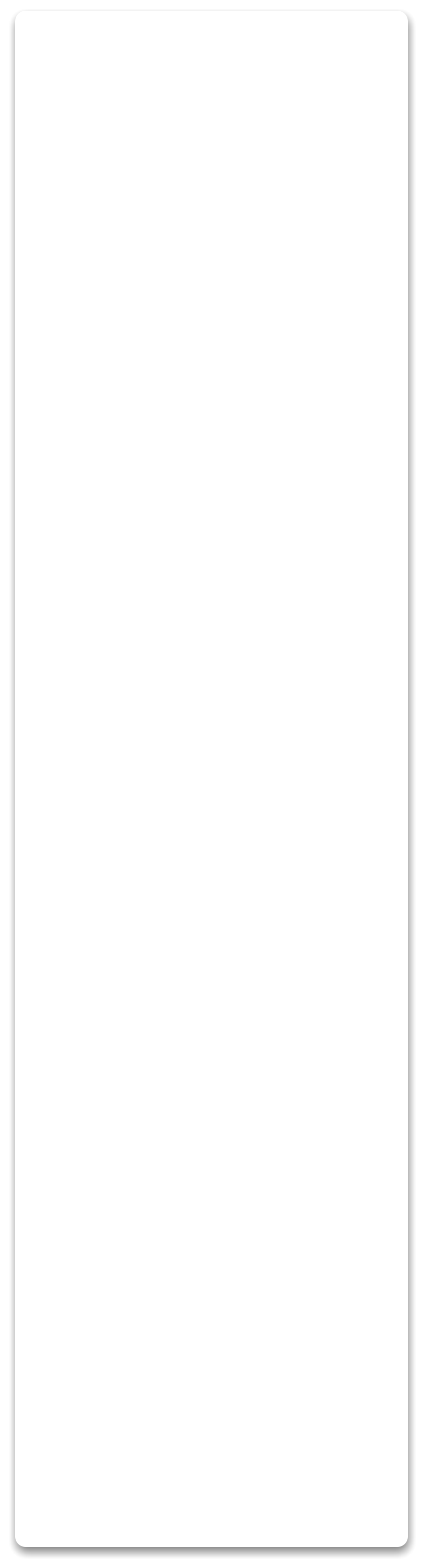
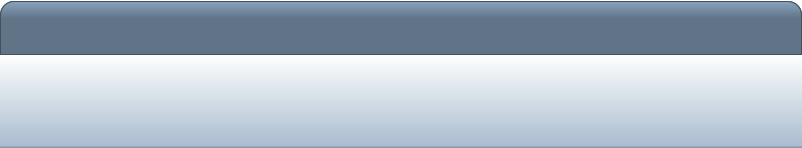







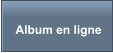


Créé en 2011, dernière mise à jour : Bernard LECLERCQ - 06/10/2015




Le principal et le plus dangereux prédateur de l'abeille est L'APICULTEUR lui même.
Il faut bien vous dire qu'une méthode de conduite des ruches et comportant des anomalies, cas très fréquent de
nos jours, peut très bien fonctionner longtemps jusqu'au jour ou des problèmes externes surviennent comme par
exemple parmi d'autres : l'arrivée du Varroa ; le changement climatique et environnemental qui n'est plus régulier
et se modifie, depuis une vingtaine d'années, à la vitesse VV' alors, bien souvent, on cherche les problèmes
ailleurs alors qu'il sont devant nous.
La ruche
L'abeille s'organise en fonction du climat sous lequel elle doit survivre. Suivant la latitude, l'abeille construira ses rayons d'une
manière différente. Pour prendre un exemple, plus il fait chaud, plus l'abeille espace ses rayons. En Belgique, les multiples
contrôles sur des essaims naturels ont montré qu'elle construit des rayons espacés de 32 à 34 mm d'axe en axe.
L'apiculteur devrait donc respecter cette façon de procéder. N'oublions pas que, lorsque les premières ruches à cadres
mobiles ont été construites, il n'y avait pas tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, notamment celui qui nous
concerne le plus, le VARROA. En Belgique on préconise souvent la construction des ruches suivant un multiple de 37,5 à 38
mm soit 3 à 4 mm de trop entre les rayons. De nombreuses ruches vendues dans le commerce font 38 mm d'axe en axe et
sont non conforme à la réalité.
Pourquoi 37,5 à 38 mm ? cela provient d'un raisonnement complètement absurde qui part du principe que dans
l'espace qui sépare deux cadres (ruelle) il y a des abeilles qui s'occupent du couvain de droite et d'autres du
couvain de gauche donc, deux abeilles dos à dos, ajouter à cela l'épaisseur du cadre (2 X 1/2 cadre) = 37,5 mm à
38 mm. L'erreur vient de ce raisonnement alors qu'un espace égal à une abeille, comme dans la nature, est
suffisant pour entretenir le couvain des deux faces. Malheureusement, cette théorie est encore enseignée aujourd'hui
dans nos ruchers écoles. Qui plus est, dans ce cas, il faut aussi plus d'abeilles pour maintenir la température. Qui dit plus
d'abeilles dit aussi plus de varroas susceptible de pénétrer dans les cellules pour se reproduire. Nous savons que les varroas
se trouvant sur les abeilles en dehors de la grappe ne tiennent pas longtemps, ce sont ceux_là qu'on retrouve sur les tiroirs.
Réduisons donc l'espace entre cadres vers une valeur plus réaliste et nous diminuerons la prolifération des varroas.
Sous notre latitude, les ruches les plus conformes à la réalité sont les ruches allemandes construites suivant un
multiple de 35 mm (cadre Hoffman). L'apiculteur devrait, autant que possible, éviter d'acheter des ruches
provenant de pays chauds ou l'on construit des ruches avec cadres plus espacés par ex.: suivant un multiple de
38,5 à 39 mm comme en Italie.
Voici ci-dessous un exemple de ré agencement d'une ruche construite suivant un multiple de 38 mm.
Respectons l’abeille

Ruche Dadant 10 cadres du commerce construite sur un multiple
de 38 mm d'axe en axe (380 mm intérieur) ré-agencée en 2000 sur
glissière avec 10 cadres plus une partition finale, espace entre
cadres = 34 mm.
Aujourd'hui, cette ruche possède 11 cadres espacés de 32 mm.
Cette réorganisation est valable pour tous les types de ruches.
Voir : page cadres
Conduite
1 - Après la dernière récolte et avant le nourrissement hivernal, réduction des colonies Dadants sur 7 ou 8 cadres maximum.
En effet, en Belgique, aucune abeille, indigène ; hybride ou autres, ne nécessite plus de 8 cadres en Dadant pour hiverner.
La quantité d'abeilles ainsi que le nombre de ruelles occupées par la colonie après la dernière récolte n'est pas un
critère de décision en faveur de la réduction ou non, la moitié des abeilles présentes seront mortes bien avant
l'hiver.
Des colonies principalement des Dadants qui ont hiverné sur 10 et 12 cadres sont parfois retrouvées mortes avec des
provisions en suffisance, c'est parce que la colonie étant limitée en hauteur, stocke les provisions dans les cadres latéraux, à
gauche et à droite et très peu dans le haut. Lorsqu'elle consomme, la grappe se déplace dans une seule direction, soit à droite
ou à gauche. Lorsqu'elle est arivée en fin de course contre paroi, elle est obligée de se déplacer vers les provisions se trouvant
à l'opposé en traversant une barrière de froid. Suivant les conditions météo, si la température est très basse, elle n'y arrive pas
et reste figée par le froid.
2 - Réagencement intérieur des ruches avec cadres à une distance plus conforme à la réalité cad de 32 à 34 mm d'axe en axe
(35 mm en Hoffman). Montage sur glissière avec partition finale. Cette façon de procéder facilite aussi la visite des colonies.
3 - Largeur des cadres 25 mm. Des cadres plus larges donnent des cellules plus profondes, donc de plus grand volume
favorisant la reproduction des varroas. Dans une construction naturelle, les cellules ont 12 mm de profondeur voir : géométrie
de la cellule. Par contre, des cadres plus larges (29 à 30 mm) peuvent s'avérer parfois très intéressants mais uniquement
pour les hausses à miel.
4 - Plus de cire dans le couvain quelque soit la saison, même si cela se pratique couramment et fonctionne très bien, ce n'est
de toute façon pas normal pour la colonie et aucune preuve du bien fondé de cette technique ne peut être fournie. Voir aussi
à ce sujet : présence de deux reines non voulues.
5 - Privilégier des cires avec un nombre de cellules se rapprochant le plus possible d'une construction naturelle. Les cires
commerciales rencontrées en Belgique varient de 750 à 780 cellules/dm2, alors que les constructions naturelles dépassent les
830 cellules/dm2 pour atteindre parfois 850. Voir : géométrie de la cellule

Afin de lutter efficacement contre les mortalités dues au Varroa
et aux produits phytosanitaires que l'on retrouve dans les
cires, l'idéal est de ne plus en mettre . C'est ce que je fais
depuis des années avec les ruches divisibles type WBC et les
Miniplus. J'hiverne des Miniplus depuis 1983, avec l'arrivée du
Varroa en 1987/88, je n'ai jamais traité ceux-ci et je n'en perd
pas si ce n'est qu'une de temps à autre morte de faim.
6 - Le nombre de visite devrait se limiter au strict minimum nécessaire : agrandissement, placement et retrait des hausses.
Eviter de visiter les ruches chaque semaine en période d'essaimage, uniquement les colonies à problèmes.
Privilégier la lecture au trou d'envol, tout apiculteur averti doit comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la ruche en
observant le trou d'envol, plus souvent on ouvre la ruche, plus on favorise aussi la reproduction des varroas.
7 - La première visite des ruches devrait absolument correspondre avec la possibilité de placer les premières cires de la
saison, chez nous cela correspond vers la mi-fin mars suivant la variété d'abeille cultivée. Il est, sauf absolue nécessité, très
néfaste de visiter les ruches plus tôt.
8 - Un point des plus important concerne la visite, pour ne jamais contrarier la grappe d'abeilles ni déranger le couvain, il faut
toujours visiter les ruches en commençant du même coté, c'est la seule méthode logique. voir : Agrandissement logique
9 - Eviter les abeilles qui ne propolisent pas. Ne nous transformons pas en fossoyeur de l'apiculture, la propolis est l'agent
hygiénique de la colonie et est essentiel à la survie de l'espèce. A terme, une colonie qui ne propolise pas et livrée à elle
même est destinée à disparaître. Trop de propolis ne facilite bien sur pas le travail de l'apiculteur qui veut garder les mains
propres, un juste milieu doit être respecté mais trop peu de propolis peut être très néfaste pour la santé de la colonie Voir :
sélection.
10 - Nourrissement terminé au plus tard fin aout, avec une quantité permettant de ne pas devoir nourrir en début d'année. Le
nourrissement peut être préventif contre la nosémose avec un sirop acidifié . Après le 15 aout, les colonies s'organisent déjà
pour hiverner, un nourrissement donné trop tardivement perturbe la grappe hivernale, affaiblit les abeilles et favorise
l'apparition des maladies dont notamment la nosémose.
11 - Eviter autant que possible l'usage du plateau grillagé. Si celui-ci permet de contrôler efficacement les infestations par
varroa, il peut occasionner, dans certains cas, mais pas toujours, de graves problèmes.
Il faut aussi savoir qu'avant l'arrivée du Varroa, il était très facile pour tout apiculteur curieux, de voir les colonies qui étaient ou
non hygiéniques, car le plateau grillagé n'existait pas. Les colonies qui s'efforçaient toujours de maintenir le plancher de la
ruche en parfait état de propreté étaient considérées hygiéniques. Avec l'arrivée du plateau grillagé, cela est devenu plus
difficile, voire impossible pour l'apiculteur et la colonie qui, au fil des ans, perd l'habitude du nettoyage, caractère des plus
importants pour la survie d'une colonie. Voir : comportement hygiénique.
Avec le plateau grillagé pour reconnaître les colonies hygiéniques il faut aujourd'hui user d'autres méthodes. Voir : abeilles
hygiéniques
12 - Eviter autant que possible d'hiverner sans fond (tirroir enlevé), il faut éviter de généraliser aveuglément quand une
nouvelle théorie est proposée, cela peut fonctionner à certains endroits mais pas forcément partout surtout si les ruches ne
sont pas protégées des vents dominants. Ce n'est de toute façon pas conforme à la nature et personne ne peut affirmer
quelque soit la situation, que cela ne provoque pas d'inconvénients aux abeilles.
Il y a de nombreuses années, bien avant le varroa, l'aération, vers l'arrière, du plateau à fond plein avait déja été préconisée et
avait dû être abandonnée, car les abeilles étaient dérangées non pas par le froid, mais par le sifflement dû au vent. Ce qui est
encore, suivant l'emplacement du rucher, le cas si le tiroir d'un plateau grillagé est ôté pour l'hiver. Le sifflement est provoqué
par les mailles du treillis.
Remarque :
Aujourd'hui, la science étudie la possibilité d'obtenir des abeilles plus tolérantes au varroa ??. Il faut être conscient que cette
abeille ne rendra service qu'à un nombre très très restreint d'apiculteurs, jamais pour l'apiculture en général et à très très long
terme sans aucune preuve de pouvoir la reproduire.
En parallèle à cette recherche, il est surtout très intéressant de se poser la question : somme nous responsable des nombreux
problèmes connus aujourd'hui ? OUI en grande partie à cause des méthodes de conduites des ruches, c'est pourquoi avant
toutes nouvelles recherches, nous devons rectifier nos erreurs et nous efforcer à pratiquer une apiculture respectueuse pour
l'abeille et sa façon de s'organiser, ce n'est malheureusement pas le cas.
Respectons l'abeille, dans le cas contraire on obtient uniquement ce que l'on mérite mais c'est dommage non pas pour
l'apiculteur mais pour l'abeille.
Rédaction & photo : Bernard Leclercq